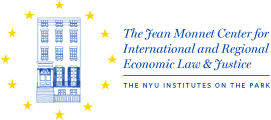
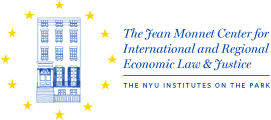 |
D'un point de vue national, le problème se présente de la manière suivante : on doit définir le fondement juridique sur lequel repose l'obligation pour les juridictions nationales de respecter et donc d'appliquer le droit de la Convention dans sa « réalité » jurisprudentielle[3]. Ainsi posée, la question ne fait pas l'unanimité car le fait même d'obliger le juge national à suivre la jurisprudence européenne suscite des controverses. Et ceci y compris les cas de figure où la Convention a été incorporée dans un ordre national. De plus, le « flou » de la terminologie complique encore les choses (portée ou effets des arrêts de la Cour de Strasbourg et même effet direct des décisions en droit interne). Cette souplesse quant aux notions masque une véritable confusion quant à l'autorité des arrêts de la Cour de Strasbourg. Commençons par ce qui est certain pour mieux démontrer l'ampleur des incertitudes.
Les arrêts de la Cour ont force obligatoire car ils sont définitifs (article 52 de la Convention) et ils sont revêtus de l'autorité de la chose jugée (article 53 de la Convention). Cette autorité joue autant pour les arrêts « déclaratoires » par lesquels la Cour dit s'il y a ou non violation de la Convention, que pour les arrêts dits de « prestation » par lesquels elle accorde une « satisfaction équitable » au requérant individuel[4] (lecture combinée des articles 50 et 53 de la Convention). En d'autres termes, la force obligatoire des arrêts de la Cour est certaine et générale. L'autorité de la chose jugée est une autorité relative certes, puisqu'elle se limite aux parties dans un litige déterminé, mais au vu des textes elle ne connaît aucune limitation dans le temps ou dans sa nature. C'est une autorité relative de la chose jugée telle qu'elle existe pour toute décision de juridiction française. Et pourtant, si l'on examine de près les effets des arrêts de la Cour de Strasbourg en droit interne, elle n'est pas une autorité de la chose jugée au plein sens du terme.
En effet, en théorie générale du droit, la conséquence sine qua non de la reconnaissance de l'autorité (relative) de la chose jugée est que le plaideur peut se prévaloir du jugement et de ses avantages. Mais les auteurs s'accordent à dire, en droit européen des droits de l'homme, que le requérant individuel qui a obtenu une décision en sa faveur avec autorité de la chose jugée ne peut pas s'en prévaloir, du moins directement, dans l'ordre national. On peut dire que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne s'imposent pas de jure aux juridictions nationales[5], ou plutôt que ces arrêts n'ont qu'une valeur déclaratoire, sans effet en droit strict sur la validité des décisions rendues dans la même affaire[6] ou même qu'il s'agit du problème plus général du défaut d'effet direct des décisions de la Cour de Strasbourg en droit interne[7]. Dans tous ces cas le résultat est le même : il s'agit de refuser, sans pour autant admettre qu'on le fait, son plein effet à l'autorité de la chose jugée que revêtent les arrêts de la Cour. Ceci nous amène à cette situation assez paradoxale : l'Etat partie au litige doit se conformer à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme mais le particulier ne peut pas se prévaloir du jugement au niveau judiciaire national alors qu'il peut obtenir réparation au niveau européen par le biais de la demande de satisfaction équitable (article 50 Convention). En définitive, ce qui manque aux arrêts de la Cour de Strasbourg c'est l'aspect positif de l'autorité de la chose jugée - la possibilité de se prévaloir du jugement et de ses avantages dans l'ordre interne - qui s'identifie à la force obligatoire. Autrement dit, la force obligatoire des arrêts de Strasbourg ne joue au niveau judiciaire national que pour un seul des litigants, l'Etat partie au litige. Elle peut ainsi être qualifiée de force passive car l'autorité même de ses arrêts est altérée et sans effet positif réel.
La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation française semble conforter cette analyse selon laquelle l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme est une autorité spécifique. En effet, la Chambre criminelle a affirmé (arrêt Kemmache du 3 février 1993), qu'« un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme... s'il permet à celui qui s'en prévaut de demander réparation, est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne »[8]. Par la suite, la Chambre criminelle persiste dans une déclaration tout aussi catégorique : « les décisions rendues par ladite Cour (Cour européenne des droits de l'homme) n'ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales »[9]. Mais alors, et si ces deux décisions sont d'une telle « rectitude juridique » comme certains auteurs l'affirment[10], on doit inéluctablement admettre, comme on vient de le faire, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de la Cour de Strasbourg est une autorité spécifique au droit de la Convention. Il s'agit bel et bien en effet d'un problème relatif à l'autorité de la chose jugée ; de plus il se pose dès que la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt. Car l'autorité de la chose jugée existe à partir du jour où l'arrêt européen a été rendu[11], malgré la possibilité d'une demande en révision[12], tout comme un jugement français a autorité de la chose jugée dès son prononcé[13], malgré la possibilité d'interjeter appel car l'effet suspensif de l'appel ne joue pas au niveau de l'autorité et ceci vaut pour l'effet négatif[14] comme pour l'effet positif[15] de cette autorité. L'appel suspend seulement la force exécutoire du jugement. En d'autres termes, et ceci constitue par là même une première objection à la qualification d'autorité spécifique, l'autorité étant de l'essence de l'acte juridictionnel, on considère que les arrêts Kemmache[16] et Saidi[17] de la Chambre criminelle ne sont pas juridiquement aussi inattaquables qu'on aurait pu le croire[18]. Vue sous l'angle de l'autorité de la chose jugée, l'explication avancée selon laquelle les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme n'ont qu'une influence pour l'avenir sur la jurisprudence des juridictions françaises constitue un contresens[19]. Elle provient sans doute de la mauvaise transposition d'une certaine jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; celle-ci, au nom du principe de la sécurité juridique, limite les effets d'un arrêt dans l'avenir, c'est-à-dire pour les actes ou situations juridiques postérieurs au prononcé de l'arrêt[20]. Elle provient aussi sans doute d'une confusion entre l'autorité de la chose jugée et l'autorité de la chose interprétée[21]. Car lorsque la Cour de Strasbourg limite à l'avenir - comme dans l'arrêt Marckx[22] - les effets d'un arrêt (suivant sur ce point la méthode de la Cour de justice des Communautés européennes)[23], l'autorité visée est celle de la chose interprétée et non celle de la chose jugée[24].
De façon générale, on doit admettre que la confusion sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne vient du fait que cette notion de l'autorité de la chose jugée a été élaborée dans le cadre des ordres juridiques internes, caractérisés par la subordination organique des tribunaux, et ceci dans une structure juridictionnelle en forme de pyramide au sommet de laquelle se trouve une juridiction suprême. On considère que l'absence d'un système judiciaire hiérarchique intégré dans l'ordre juridique européen, s'il permet d'établir que les décisions de la Cour de Strasbourg ne s'imposent pas automatiquement aux juridictions nationales[25] en ce sens que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut ni infirmer la décision nationale ni entraîner la nullité de la procédure, n'exclut en rien l'incidence directe des arrêts de la Cour sur les procès internes et ceci par le biais de la notion de l'autorité de la chose jugée. Le fait pour une juridiction interne de ne pas tenir compte d'une décision de la Cour de Strasbourg doit constituer, selon nous, une violation en soi de la Convention[26], malgré l'absence de subordination hiérarchique des juridictions, car la décision nationale se heurte à l'autorité du précédent[27] des arrêts de la Cour européenne. Cette autorité du précédent a une application générale en ceci qu'elle joue aussi bien à l'égard des parties dans un litige déterminé (Etat partie au litige et requérant individuel) qu'à l'égard des Etats non parties au litige[28]. Mais même si l'on admet pas la qualification d'autorité du précédent ici retenue, il reste que les affirmations un peu trop catégoriques de la Chambre criminelle dans les affaires Kemmache[29] et Saidi[30] ainsi que l'analyse des auteurs les approuvant sans réserve, nous laissent quelque peu perplexe. Ce qui nous frappe c'est la généralité de la motivation de la Cour de cassation. Dire que les arrêts européens n'ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales revient purement et simplement à nier toute autorité (y compris l'autorité relative de la chose jugée) aux arrêts européens. Par contre, il est incontestable que la saisine des organes de contrôle de Strasbourg ne produit aucun effet suspensif en droit interne ; les juridictions françaises n'ont pas à surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour européenne. De même, le juge français n'a pas à se confronter à la fin de non-recevoir (article 122 nouveau code de procédure civile) tirée de la chose jugée européenne dans une affaire pendante car le contrôle opéré à Strasbourg est subsidiaire ; il ne se déclenche qu'après épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention). C'est en ce sens, et ce sens seulement, que l'autorité des arrêts de la Cour de Strasbourg connaît une certaine limitation : elle ne se déclenche qu'une fois le contrôle national opéré. Autrement dit, la mise en oeuvre de cette autorité spécifique aux arrêts de la Cour de Strasbourg a lieu, en principe, suite à au moins une décision juridictionnelle interne qui possède, également, l'autorité de la chose jugée. Une fois remplie la condition établie par l'article 26 de la Convention, les arrêts européens ont une incidence directe sur les décisions des juridictions nationales et cette influence n'est dans aucun cas limitée à l'avenir ; ceci explique le conflit entre l'autorité de la chose jugée par la juridiction française et l'autorité de la chose jugée par la Cour de Strasbourg. C'est pourquoi on affirme que la motivation de la Chambre criminelle, en raison même de sa généralité, risque de nuire à la matière car elle conduit à exclure l'acte juridictionnel européen au niveau national. Les voies de recours nationales étant épuisées, les organes de contrôle de Strasbourg prennent le devant et l'autorité dont sont revêtus les arrêts européens trouve alors sa pleine vocation. Nier aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme l'autorité de la chose jugée dans un cas d'espèce conduit à nier sa compétence même à trancher la question de la violation de la Convention dans une affaire déterminée.
Tel est surtout le sens qu'on doit attribuer aux termes de l'article 50 de la Convention selon lequel la Cour européenne des droits de l'homme accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable ; elle le fait si le droit interne ne permet d'en effacer qu'imparfaitement les conséquences d'une décision prise ou d'une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ou toute autre autorité nationale, lorsque elle est en opposition avec les obligations découlant de la Convention[31].
La Convention institue un système de contrôle et de réparation subsidiaires par rapport au système national[32]. Tout le sens de la Convention est là : Elle renvoie au niveau judiciaire national aussi bien pour le contrôle initial (article 26 instituant la règle de l'épuisement des voies de recours internes) que pour la réparation une fois la violation constatée (article 50). Alors que lorsque le contrôle du respect de la Convention par les juridictions nationales s'avère, aux yeux du justiciable, inefficace, il saisit les organes de contrôle de Strasbourg (article 25), de même, lorsque la réparation au niveau national est insuffisante, la Cour intervient pour accorder la satisfaction qui convient.
Il ne faut pas lire dans l'article 50 plus qu'il n'en dit[33]. Dans un arrêt déclaratoire, la Cour constate le manquement au droit de la Convention. L'Etat en violation de la Convention doit se conformer à la décision de la Cour. C'est la solution principale. S'il ne le fait pas ou si la réparation est inadéquate, la Cour intervient à nouveau pour accorder, au titre de l'article 50, une satisfaction équitable. C'est la solution subsidiaire. Tout au plus, comme le souligne le professeur Flauss, le mécanisme instauré par l'article 50 permet-il à la Cour « de prendre parti sur le caractère suffisant des mesures adoptées par l'Etat défendeur pour exécuter l'arrêt de condamnation rendu contre lui au principal... »[34] Mais, cette fonction de surveillance implicite mise à part et contrairement à ce que pensent certains auteurs[35], il n'existe rien dans ce mécanisme qui permette d'affirmer qu'il n'y a pas obligation d'introduire en droit interne l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. De même, l'existence d'un mécanisme de contrôle instauré à Strasbourg (Commission et Cour) ne signifie en rien - tout à fait au contraire - qu'il n'y a pas au niveau judiciaire national obligation de se conformer à la Convention.
L'arrêt européen s'introduit en droit interne par l'effet de son autorité. Il n'annule pas en soi la décision juridictionnelle interne à cause de l'absence de subordination hiérarchique des juridictions internes aux juridictions européennes et non pas aussi en raison d'une lecture implicite de l'article 50[36]. Dans le cas contraire et par analogie, l'introduction depuis le Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht) du mécanisme des sanctions pécuniaires (somme forfaitaire ou astreinte) prévues en cas d'inexécution d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes constatant un manquement (article 171 nouveau C.E.), signifierait désormais, de manière implicite mais certaine, que les auteurs du Traité de Maastricht reconnaissent l'absence d'obligation de se conformer à l'arrêt constatant le manquement en droit interne, ce qui relève d'une absurdité.
Et pourtant, l'argument ici avancé - selon lequel l'arrêt de la Cour européenne s'introduit en droit interne par l'effet de son autorité (toute autre conclusion amènerait à nier la nature pleinement juridictionnelle de la décision de la Cour déclarant qu'il y a eu violation de la Convention) et surtout que le mécanisme de réparation prévu à l'article 50 n'a rien à voir avec ce phénomène propre au jeu de l'autorité de la chose jugée - semble se heurter à rien de moins qu'aux conclusions d'un certain Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour la question de l'amélioration des procédures de protection des droits de l'homme[37]. Selon ce Comité : « L'article 50 donne aux Etats contractants la faculté de ne pas mettre en question le caractère définitif et exécutoire des décisions des justice internes. Conformément à l'opinion générale, la Convention ne prévoit pas l'obligation de donner effet, en droit interne, aux arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme de façon à annuler l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice interne qui, selon la Cour de Strasbourg, est contraire à la Convention. Eu égard particulièrement au principe bien établi de la res judicata ou autorité de la chose jugée - le principe de la « force exécutoire » - et à la grande considération dont il jouit dans les ordres juridiques internes, l'article 50 de la Convention indique clairement que les Etats membres peuvent maintenir intacte la « force exécutoire » des décisions de justice »[38]. A ceci, une objection et une remarque. L'objection tout d'abord : le Comité d'experts opère un amalgame entre l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Dans la théorie processuelle française, la force exécutoire émane de la force obligatoire mais ne s'identifie pas à elle. Les deux notions sont dissociables[39]. En d'autres termes, le Comité d'experts qui est supposé améliorer les procédures ignore la distinction la plus élémentaire du droit processuel. Ainsi, comme il a été déjà indiqué, un jugement a, en droit positif français, autorité de la chose jugée dès son prononcé, malgré l'effet suspensif de l'appel qui ne joue qu'au niveau de la force exécutoire. De même, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont force obligatoire (art. 53) mais ne valent pas titre exécutoire. Dans les deux cas de figure la force exécutoire se distingue clairement de la force obligatoire qui s'identifie à l'aspect positif de l'autorité de la chose jugée.
La remarque ensuite : il est vrai que la Convention ne prévoit pas le mécanisme pour annuler l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice interne ; c'est une lacune regrettable, mais comment pourrait-il en être autrement puisque cette Convention n'impose même pas l'obligation de son incorporation dans l'ordre national ? En revanche la question de la res judicata des arrêts européens en droit interne est indépendante du mécanisme de réparation prévu par l'article 50. Autrement dit, et si, malgré l'arrêt de principe Hornsby c/ Grèce[40], le problème relatif à l'exécution des arrêts de la Cour de Strasbourg est toujours en partie non résolu à cause du conflit de l'autorité de la chose jugée de la décision interne et de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ce conflit est distinct des dispositions de l'article 50. L'impasse actuelle provient d'un conflit d'autorité de la chose jugée qui se transforme, par la suite, en un problème d'exécution. Le mécanisme de l'article 50 est tout simplement une soupape de sécurité supplémentaire et non pas un indice de l'absence d'introduction de l'arrêt européen en droit interne.
A l'appui de notre argument selon lequel les dispositions de l'article 50 qui prévoient la demande de satisfaction équitable ne confirment en rien l'absence d'une obligation d'introduction de l'arrêt de Strasbourg en droit national car ces dispositions de l'article 50 sont étrangères à la question de l'autorité de la chose jugée par l'effet de laquelle l'arrêt européen s'introduit en droit interne, vient la jurisprudence même de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de satisfaction équitable. En effet, la demande de satisfaction équitable prévue par l'article 50 n'est pas une requête nouvelle[41] ; il s'agit seulement de la phase ultime de la procédure engagée devant la Cour par la requête individuelle, et donc, la condition d'épuisement des voies de recours internes (prévue par l'article 26 de la Convention) ne s'applique pas à la demande de satisfaction équitable[42]. A contrario, si la demande de satisfaction équitable constituait une requête nouvelle, la décision consécutive à cette demande aurait l'autorité de la chose jugée ; elle lui serait propre et pourrait nuire indirectement à l'autorité de l'arrêt déclaratoire de la Cour en l'empêchant de s'introduire en soi en droit interne[43]. Par analogie, le fait que le juge national puisse saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'un renvoi préjudiciel malgré une première interprétation donnée par la Cour de Luxembourg et que cette nouvelle saisine constitue un nouveau renvoi préjudiciel confirment que l'autorité des arrêts préjudiciels n'est pas une autorité de la chose jugée[44].
Une fois la question de l'article 50 écartée du domaine de réflexion relatif à l'autorité de la chose jugée des arrêts rendus par la Cour de Strasbourg, on entre dans le vif du sujet. Jusqu'à présent, nous pensons avoir établi que l'autorité de la chose jugée est une question autonome quant à sa nature par rapport au problème de réparation d'une violation à la Convention ; nous admettons par là même - et c'est une évidence - que la restitutio in integrum peut se heurter à l'autorité de la chose jugée des décisions internes.
Ceci dit, il nous reste à cerner la notion de la res judicata dans son expression européenne, d'autant que le droit européen, en évolution permanente, exige une précision particulière. Délimiter la notion de l'autorité de la chose jugée telle qu'elle est appliquée en droit de la Convention ne signifie pas lui donner un sens européen. Donner un sens autonome - admettre par exemple qu'il s'agit tout simplement d'une autorité spécifique ayant un aspect positif restreint - à un concept aussi primordial que la res judicata, revient à nuire à la cause européenne au sens large ; cela nuit aussi à la sécurité juridique, au niveau tant national que supranational[45]. L'enjeu est tel qu'à notre avis en introduisant un concept aussi imprécis que l'autorité spécifique, (même si l'on procède à analyser ses effets), d'une part on risque de s'éloigner de la notion de la chose jugée telle qu'elle a été élaborée par la doctrine nationale au fil des temps, ayant surtout durée dans le temps, d'autre part on frôle l'arbitraire.
Notre but est, dans un souci de précision, de ne pas trop s'éloigner des solutions élaborées au niveau national ; cependant on se permet - mais une fois n'est pas coutume - quelque critique à l'analyse de la question d'autorité telle qu'elle a été élaborée par les professeurs Velu et Ergec[46]. Voyons la conclusion de l'analyse du professeur Velu. Selon lui « si l'autorité de la chose interprétée par la Cour européenne deviendra progressivement, avec le temps, déterminante pour les juridictions nationales de ces Etats, la juridicisation progressive de cette autorité restera un phénomène limité à une minorité d'Etats, alors que pour la majorité de ceux-ci, cette autorité continuera à relever de l'infra-droit, pour ne pas dire du non-droit[47] ». Si la juridicisation progressive de cette autorité reste dans l'avenir un phénomène limité, l'autorité même continuant à relever de l'infra-droit, n'est-ce pas aussi, en raison de l'imprécision qui caractérise le domaine et la portée de l'autorité européenne telle qu'élaborée jusqu'à présent ?
Le reproche est en effet double. D'une part, si l'autorité de la chose interprétée permet d'expliquer pourquoi les juridictions nationales sont obligées de suivre la jurisprudence de la Cour de Strasbourg au-delà du cas d'espèce, elle n'explique en rien le comment, puisqu'elle ne précise aucunement les modalités de l'application de cette jurisprudence européenne. L'autorité de la chose interprétée n'est certainement pas une mauvaise réponse ; elle n'en est que le début d'une réponse. La notion permet d'éviter le piège de l'autorité absolue - terme contestable en soi et qui, de plus, énonce un effet obligatoire erga omnes, manifestement contraire au texte (article 53 de la Convention)[48] - elle constitue surtout le fondement de l'obligation pour les juridictions nationales de tenir compte de la jurisprudence européenne en dehors du cas d'espèce[49]. L'autorité de la chose interprétée se justifie par le principe du seuil minimum d'efficacité, principe commun aux droits communautaire[50] et de la Convention[51] ; il postule l'homogénéité des solutions jurisprudentielles dans un souci d'harmonisation malgré l'absence d'un système judiciaire hiérarchique intégré. Et c'est tout. Contrairement à ce que semblent avancer les professeurs Velu et Ergec[52], l'élaboration du concept de l'autorité de la chose interprétée en droit de la Convention ne constitue pas une transposition de la solution adoptée en droit communautaire quant à l'autorité des décisions préjudicielles (article 177 C.E.), mais sur ce point crucial nous reviendrons[53].
D'autre part, le second aspect de notre objection à l'analyse avancée par MM. Velu et Ergec concerne l'autorité de la chose jugée ; ces auteurs éminents déclarent que cette autorité européenne a un effet positif et un effet négatif. L'effet positif tient « à ce que l'arrêt par lequel la Cour déclare qu'un acte de l'Etat défendeur constitue ou non une violation d'une obligation découlant de la Convention ou décide qu'il y a lieu ou non d'accorder à la partie lésée une satisfaction équitable, doit être considéré comme correspondant à la vérité : res judicata pro veritate habetur »[54]. Cette analyse de l'effet positif de l'autorité de la chose jugée trouve un écho certain dans une partie de la doctrine processuelle française[55]. On considère, au contraire, que Velu et Ergec esquivent d'une certaine façon le problème au niveau européen. Prétendre que la présomption de vérité constitue l'effet positif de l'autorité de la chose jugée conduit à vider de tout sens l'aspect positif. De plus, pourquoi l'adage res judicata pro veritate habetur serait-il lié uniquement à l'aspect positif de l'autorité de la chose jugée ? A partir du moment où la chose jugée est tenue pour vraie (présomption de vérité), il est inutile et dangereux de soumettre à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé. Surtout, prétendre que l'effet positif de la chose jugée se limite à la seule présomption de vérité est une manière de contourner le véritable problème, à savoir : l'absence d'effet positif de cette autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dès lors que le particulier ne peut pas se prévaloir pleinement du jugement européen et de ses avantages au niveau national de l'ordre juridique européen.
Toutes ces raisons nous conduisent à penser qu'il serait indispensable de réexaminer la qualification attribuée à l'autorité des arrêts de la Cour de Strasbourg à la lumière d'une conception moins manichéenne que celle qui consiste à voir le seul jeu de l'autorité de la chose interprétée dans les affaires dépassant le cas d'espèce, alors que la véritable autorité de la chose jugée ne se limite que dans ce cas.
[3] Selon l'expression du Professeur G. Cohen-Jonathan. V. G. Cohen-Jonathan, « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme », Mélanges M.-A. Eissen, Bruylant Bruxelles, LGDJ Paris 1995 p. 39 et s., spéc. p. 53.
[4] Sur la distinction V. G. Cohen-Jonathan, Jurisclasseur. Europe, Fasc. 6510, n° 138.
[5] J.-F. Renucci, « La portée des arrêts de la Cour E.D.H. », Dalloz 1993, Jur. p. 515 ; R. de Gouttes, « Le juge judiciaire français et la Convention européenne des droits de l'homme : Avancées et réticences », in P. Tavernier, Quelle Europe pour les droits de l'homme ? Préface P.-H. Imbert, Bruylant Bruxelles 1996, p. 217 et s., spéc. p. 231.
[6] P. Chambon, JCP 1994, II, 22197.
[7] G. Ress in la Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert, Préface P.-H. Teitgen, Economica 1995, p. 857 ; V. aussi J. Velu et R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant Bruxelles 1990, n° 1211.
[8] Cour de cass. crim., 3 février 1993, Kemmache, Bull. crim. n° 57, p. 132 ; Dalloz 1993, Jur. p. 515, note Renucci ; JCP 94, II, 22197, note Chambon.
[9] Cas. crim., 4 mai 1994, Saidi, Dalloz 1995, Jur. p. 80, note Renucci ; JCP 94, II, 22349, note Chambon.
[10] V. J.-F. Renucci, préc. ; V. aussi R. de Gouttes op. cit., loc. cit. L'avocat général Régis de Gouttes inscrit ces deux décisions (Kemmache et Saidi), tout en s'abstenant de les critiquer, dans un mouvement tendant à limiter les effets des arrêts de la Cour européenne en droit interne ; V. P. Chambon, préc. Pierre Chambon croit voir dans les arrêts de la Cour européenne « une influence pour l'avenir ».
[11] V. J. Velu et R. Ergec, op. cit., n° 1226.
[12] Règlement de la Cour, article 58. La révision d'un arrêt européen présuppose la découverte d'un fait nouveau et décisif à la solution du litige. V. Sur la question G. Cohen-Jonathan et J.-F. Flauss, Revue Justices, 1997-5, p. 179 et s.
[13] V. art. 480 Nouveau code de procédure civile ;Civ. 3 janvier 1979, Bull. Civ. II, n° 3 p. 2, Dalloz 1979, IR p. 510, obs. Julien ; Civ. 25 mars 1985, JCP 1987, II, 20823, note Blaisse.
[14] Com. 2 mars 1976, Gaz. Pal. 1976. 2. 456, Bull. civ. IV, n° 75, p. 65.
[15] Civ. 11 juin 1991, Bull. civ. I, n° 189, p. 124, RTD civ. 1992, p. 187, note R. Perrot.
[16] Préc., note 8.
[17] Préc., note 9.
[18] Contra J.-F. Renucci, Dalloz 1995, Jur. p. 80. Selon le Professeur Renucci la solution de la Chambre criminelle dans l'arrêt Saidi est juridiquement inattaquable.
[19] Contra P. Chambon, JCP 94, II, 22349. Selon Pierre Chambon les arrêts européens n'ont une influence que pour l'avenir sur la jurisprudence des juridictions françaises.
[20] V. p. ex. C.E.D.H., 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, Série A, n° 31 in Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Sirey, 4e éd., 1994, n° 696.
[21] V. Infra.
[22] Préc., note 20.
[23] C.J.C.E., 8 avril 1976, aff. 43/75, Rec. p. 455.
[24] V. en ce sens J. Velu et R. Ergec, op. cit., n° 1234.
[25] V. en ce sens H. Steinberger, « La référence à la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'homme devant les tribunaux nationaux, « Actes du 6e colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme, Séville 1985, p. 733 et s., spéc. p. 743 ; V. aussi G. Ress, « Effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en droit interne et pour les tribunaux nationaux », Actes du 5e colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme, Francfort 1980, Paris Pedone 1982, p. 235 et s.
[26] Contra G. Ress, op. cit.,loc. cit.
[27] V. infra La solution avancée : l'autorité du précédent.
[28] Contra H. Steinberger, op. cit., p. 747.
[29] Préc., note 8.
[30] Préc., note 9.
[31] Sur l'analyse de la question de l'imputation à un Etat du comportement dont il est allégué qu'il viole les règles des droits de l'homme V.H. Dipla, La responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme, Problèmes d'imputation, Avant-propos N. Valticos, Préface L. Condorelli, Paris Pedone 1994.
[32] V. par ex. CEDH, 7 déc. 1976, Handyside, Série A, n° 24, par. 48 : "le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l'homme".
[33] V. en ce sens G. Cohen-Jonathan, « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme », op. cit., p. 42-43.
[34] J.-F. Flauss, Actualité de la C.E.D.H., L'Actualité Juridique-Droit Administratif (AJDA), 20 octobre 1995.
[35 ]H. Golsong, « L'effet direct ainsi que le rang en droit interne des normes de la Convention européenne des droits de l'homme et des décisions prises par les organes institués par celle-ci », in Les recours des individus devant les instances nationales en cas de violation du droit européen, Bruxelles 1978, p. 59 et s., spéc p. 82.
[36] Contra J. Velu, « Les responsabilités incombant aux Etats Parties à la Convention européenne », Actes du 6e colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme, Séville 1985, Strasbourg, Dordrecht, Boston, Londres, 1988, p. 533 et s., spéc. p. 573.
[37 ]Selon Marc-André Eissen, greffier à la Cour de Strasbourg, l'auteur de ce rapport est M. Abraham. V. Débats dans Actes du colloque de Rouen de Mai 1995 in Quelle Europe pour les Droits de l'Homme ? op. cit., p. 330 ; le rapport en question est une étude comparative par ailleurs intéressante sur le thème de l'instauration d'une procédure de révision au niveau national pour faciliter la conformité avec les décisions de Strasbourg.
[38 ]Conseil de L Europe, « La C.E.D.H.: Instauration d' une procédure de révision au niveau national pour faciliter la conformité avec les décisions de Strasbourg," Revue Universelle des droits de l'homme, 1992, Volume 4, p 127 et s, spéc. p. 128.
[39] V. à titre indicatif R. Perrot, Encyclopédie Dalloz, Répertoire procédure civile, V° Chose jugée n° 12 et 13.
[40 ]C.E.D.H.,19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce. Dans cette affaire, la Cour déclare formellement que le droit d'exécution des décisions de justice fait partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
[41 ]C.E.D.H., 10 mars 1972, De Wilde, Ooms et Versyp c/ Belgique,Série A, n° 14.
[42 ]C.E.D.H., 31 octobre 1995, Papamichalopoulos c/ Gréce, série A, n° 330 B, JCP 96, I, 3910, Chronique F. Surdre, n°7 et n°45.
[43] Mais V. C.E.D.H., 19 février 1991 et 10 février 1993, Zanghi c/ Italie, Série A, n° 194 et n° 257A, AJDA 1993, p. 486, obs. crit. Flauss. La Cour déclare reçevable la demande de satisfaction équitable dans le second arrêt du 10 février 1993, alors qu'elle avait rejeté ladite demande dans le premier arrêt. La solution est limitée au cas d'espèce.
[44] En ce sens V. D. Simon, Le système juridique communautaire, PUF 1997, n° 498, p 483, note 2.
[45] A rapprocher, Laurence Helfer et Anne-Marie Slaughter, "Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication", 107 YaleLJ, 273 (1997), spéc. p. 318 et s. Les auteurs mentionnent expressément la qualité du raisonnement juridique comme étant un des facteurs qui contribuent au succès d'un contrôle juridictionnel supranational.
[46] J. Velu et R. Ergec, op.cit., n° 1211 et s.
[47 ]J. Velu, "A propos de l'autorité jurisprudentielle des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme : Vues de droit comparé sur des évolutions en cours", Mélanges F. Rigaux, Bruxelles 1993, p 527 et s., spéc. p. 562.
[48] V. en ce sens G. Ress, « Effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en droit interne et pour les tribunaux nationaux », op. cit., p 243-4.
[49] V. en ce sens G. Cohen-Jonathan, « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme », op. cit, p.55.
[50] G. Issac, Droit communautaire général, 5e éd., 1996, p. 215.
[51 ]G. Cohen- Jonathan, « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne », op. cit., loc. cit.
[52 ]J. Velu et R. Ergec, op. cit, n° 1234.
[53 ]Voir Infra
[54 ]J. Velu et R. Ergec, op. cit., n°1228.
[55 ]En ce sens V.H. Croze et C. Morel, Procédure civile, PUF 1988, n° 66. On préfère ici la définition avancée par J. Vincent et S. Guinchard selon laquelle l'aspect positif tient à ce que le plaideur dont le droit a été reconnu peut se prévaloir de jugement et de ses avantages. V. J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, 24e éd. Dalloz 1996, n° 179.